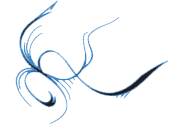Extrait
J’allume la radio, France Inter, plusieurs centaines de jeunes banlieusards affrontent les policiers à Clichy-sous-Bois, à Montfermeil. Je situe à peine ces bleds. Il y a trois jours, deux jeunes ont trouvé la mort en enjambant les grilles d’un transformateur EDF, un troisième a survécu, grièvement blessé. Depuis, les déclarations des hommes politiques sont transmises en boucle. L’un parle de fuite, de vol, de contrôle d’identité. L’autre qualifie les événements de « terrible drame humain». Un autre encore parle de tentative de cambriolage, d’intervention de la police, de la fuite des casseurs, dont ces trois jeunes qui n’étaient, dit-il, «pas poursuivis avant qu’ils ne se réfugient derrière l’enceinte qui abritait le transformateur ». En marge de ces controverses, le parquet de Bobigny dément les rumeurs de vol et réhabilite la mémoire de ces jeunes garçons. Le résultat, c’est qu’une trentaine de voitures ont déjà été brûlées cette nuit, les forces de l’ordre ont essuyé des tirs, une balle a traversé un véhicule CRS.
Tout porte vers l’imbroglio judiciaire, un vrai micmac.
Je suis perplexe quand je pense à la situation fragile des banlieues françaises. Je me questionne quant au fait que les autorités n’ont rien vu venir. Lors d’une enquête précédente, j’ai été surpris de trouver à Saint-Denis, en banlieue parisienne, un commissariat construit comme un blockhaus entouré de grillages. Pas croyable, je me suis dit, une armée d’occupation ne ferait pas mieux. J’y ai trouvé des collègues exténués, démotivés, sur le départ. Tous des gamins, des flics au-dessous de trente ans. Pas un seul n’habitait le secteur, n’y faisait ses courses, n’y prenait ses repas ou n’y pratiquait une activité culturelle. Ça m’a intrigué. Dans ces conditions comment pouvaient-ils faire leur boulot de flic ?
Dans ma carrière, j’ai retenu que le policier doit être parfaitement intégré dans son milieu pour bosser ; c’est une chose d’avoir des informations sur tout et sur rien, mais une autre que d’obtenir du renseignement, et le renseignement passe nécessairement par une approche de proximité.
Par ailleurs, j’avais été très bien reçu par mes camarades qui ont plutôt apprécié de dire leur déprime à un collègue suisse.
Je me souviens d’un grand gaillard qui, tout en ricanant, m’a montré sa nouvelle arme de service, un Sig Sauer, me disant qu’elle était neuve, que l’ensemble de la police nationale devait en toucher, mais que c’était bien la dernière chose dont il avait besoin ici pour travailler, que les outils les plus élémentaires pour le maintien de la paix dans les cités avoisinantes manquaient.
— Nos hiérarchies ont pensé investir dans de nouvelles armes, ah oui, alors, ça, ils pensent, et chez vous ça se passe comment ?
J’ai haussé les épaules, à Genève nous avions remplacé le Sig Sauer par le Glock autrichien, nos hiérarchies ont décidément les mêmes préoccupations. Un peu cruchon tout ça. Nous avons ri jaune.
Comme mon enquête à Saint-Denis était sur le point d’être résolue, des collègues m’ont proposé une tournée jusqu’à la Courneuve pour me montrer les difficultés auxquelles ils doivent faire face.
Nous avons filé en voiture banalisée, et en civil. Nous avons passé la basilique, traversé la A1 et je me suis retrouvé devant des barres d’immeubles bétonnés. Pas terrible, mais pas non plus tout à fait le Bronx que mes camarades m’avaient laissé entendre. J’ai senti leur paranoïa et leurs craintes. La jeunesse, sans doute.
Petite escapade hors du véhicule, mes trois collègues marchent en position de tirailleurs, flash-balls à la main, la tête dévissée pour observer d’où pourraient venir les coups. Je sors les mains de mes poches pour ne pas paraître trop décontracté à leurs côtés, d’autant qu’ils ont presque réussi à me communiquer leur frousse.
On croise de jeunes blacks adossés contre un mur, je les salue, personne ne me répond. De retour dans la voiture je me fais enguirlander comme pas deux: — T’es dingue de dire bonjour, tu vas nous foutre le bordel. C’est shit cities ici, me râle dessus le conducteur.
— Vous ne dites pas bonjour ? je questionne. Mon zig me regarde de travers.
— De toute manière ils t’ont pas répondu.
C’est là une vraie réponse de flic. J’ai regardé par la fenêtre en fermant ma gueule.
Les interventions se sont succédé durant l’après-midi. Je me souviens qu’une gamine d’à peine quatorze ans a ramassé une baffe dans le bistrot portugais du coin. Ma petite équipe a investi le bistrot, les clients ont cru à un braquage. J’ai trouvé cocasse que les flics flanquent plus la cliche que les truands. Finalement, le petit copain qui avait rossé la gamine avait déguerpi. Nous sommes repartis sans traiter l’affaire. Affaire courante.
En quelques heures j’ai vécu de quoi me questionner sur l’état de délabrement des relations entre les flics et une certaine population en France. Tout ça doit bien venir de quelque part ? Je n’ai pas vraiment eu de réponse, si ce n’est de quelques camarades qui m’ont laissé entendre que le pouvoir politique doit être gagnant du fait de l’existence de ce bordel, que l’insécurité est un bon sujet électoral, que jamais les policiers n’ont autant été sous tension, faut qu’ils fassent du chiffre, des statistiques… encore une de ces conneries à laquelle aucun flic ne croit.
Bon, j’éteins la radio, en définitive je ne suis pas chez moi, je suis rue Caulaincourt, et ces affaires de maintien de l’ordre, à défaut de celles de paix, ne me concernent plus vraiment. Clichy-sous-Bois et Montfermeil peuvent se passer de moi. Aujourd’hui j’enquête. J’ai passé la main. En principe, finies les heures casquées, finis les coups de matraque, les côtes froissées, les courses à pied chaussé de rangers, muni de jambières et d’un gilet pare-coups, d’un masque à gaz et d’un bouclier. Finies ces nuits d’épuisement et de peur.
J’ai comptabilisé presque une vingtaine d’années dans la police: seize ans de patrouilles et, aujourd’hui, des enquêtes à la brigade d’investigation spéciale, la BRI, en relation quasi quotidienne avec Europol. Le job est intéressant et il n’y a plus la pression de l’uniforme. L’enquêteur passe presque inaperçu, du moins chez le citoyen lambda. Pour les truands, c’est une autre histoire. Une gueule de flic reste une gueule de flic, avec ou sans uniforme.
Plus d'info sur l'auteur, ses oeuvres et ses activités cinématographiques: www.flicdequartier.ch